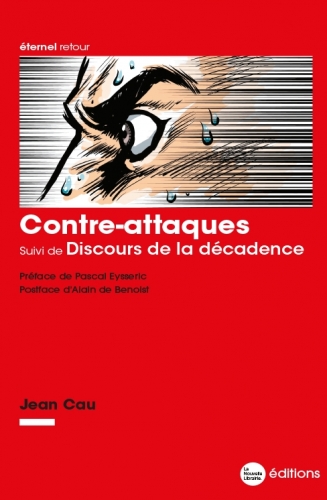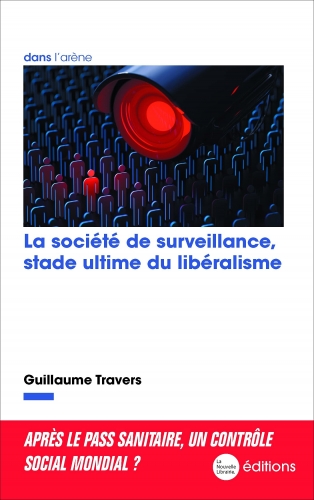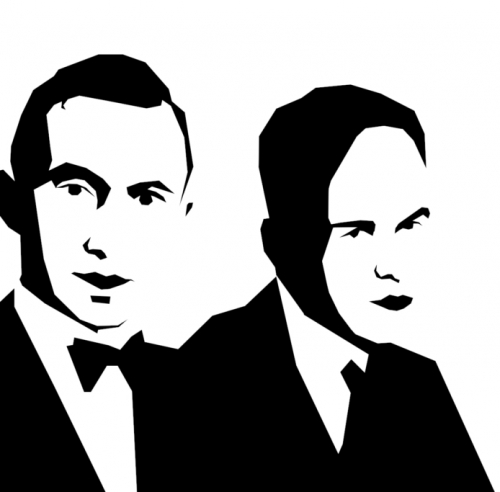Alain de Benoist : « Aucune élection, fût-elle présidentielle, ne peut créer les conditions de la véritable révolution dont notre peuple a besoin »
Breizh-info.com : Alain de Benoist, tout d’abord, quel regard portez-vous sur l’ascension médiatico-politique d’Eric Zemmour à quelques mois de l’élection présidentielle ? Cette ascension n’est-elle pas le signe de l’échec définitif du Rassemblement national en politique ?
Alain de Benoist : Toute campagne présidentielle en France a ses coups de théâtre et ses événements imprévus. Cette année, c’est le phénomène Zemmour. Je le regarde avec curiosité – mais aussi avec détachement, tant je reste convaincu qu’aucune élection, fut-elle présidentielle, ne peut créer les conditions de la véritable révolution dont notre peuple a besoin.
Eric Zemmour est un ami, dont je connais la vaste culture politico-historique et dont j’admire la posture réfractaire et la pugnacité, ce qui ne m’empêche d’être en désaccord avec lui sur des points nombreux (son jacobinisme, sa critique de l’idée d’Empire, son parti-pris sans nuances pour l’assimilation, son hostilité aux prénoms régionaux, pour ne rien dire de la question des « racines chrétiennes »). Son ascension de « presque candidat » a été remarquable, puisqu’il semble être aujourd’hui en mesure d’empêcher Marine Le Pen d’arriver en tête au premier tour, voire de l’empêcher d’être présente au second. Cela dit, à six mois du scrutin, rien n’autorise à faire un pronostic. Zemmour peut très bien continuer à progresser, comme Macron en 2017, ou s’effondrer brusquement, comme Chevènement en 2002.
Au départ, la candidature Zemmour a été soutenue, d’un côté par des républicains d’accord avec Marine Le Pen sur l’immigration, mais qui trouvent trop extrémistes ses positions en matière sociale, et par une farandole de déçus du Rassemblement national qui lui reprochent au contraire d’avoir excessivement voulu se dédiaboliser au risque de « banaliser » son discours, leur grand objectif étant, non pas d’empêcher la réélection de Macron, mais de « dégager définitivement Marine ». Le problème est évidemment qu’il est difficile de séduire durablement des gens qui trouvent cette dernière trop radicale et d’autres qui trouvent qu’elle ne l’est pas assez…
Je pense par ailleurs que l’on aurait tort d’enterrer trop vite Marine Le Pen. En dépit de l’état lamentable du RN (mais à une présidentielle, on vote pour une personne, pas pour un parti), elle reste la candidate préférée des classes populaires. Zemmour, tout à son désir de « réinventer le RPR », dit vouloir réconcilier les classes populaires et la « bourgeoisie patriote » (ou fusionner la sociologie de la Manif pour tous et celle des Gilets jaunes), mais pour l’instant il ne touche pratiquement pas les premières, qui le connaissent en outre assez peu. Il l’a indirectement reconnu lorsqu’il a déclaré, le 22 octobre, que « Marine Le Pen n’a pour elle que des classes populaires, elle est enfermée dans une sorte de ghetto ouvrier et chômeur, qui sont des gens tout à fait respectables et importants, mais elle ne touche pas les CSP+ et la bourgeoisie ». Zemmour, lui, connaît surtout du succès auprès des anciens électeurs de Fillon et de Bellamy, des CSP+ et des cathos versaillais, c’est-à-dire auprès de cette petite et moyenne bourgeoisie qui craint pour son avenir et son identité parce qu’elle s’inquiète de son insécurité culturelle, mais très peu d’une insécurité économique qui est au contraire l’une des préoccupations majeures d’une « France périphérique » qui, comme l’a dit Marine Le Pen, « n’acceptera pas d’être sacrifiée à une vision ultralibérale de l’économie ».
Il y a en fait deux façons bien différentes de concevoir la formation d’un nouveau bloc historique à vocation hégémonique : l’« union des droites » et ce que Christophe Guilluy ou Jérôme Sainte-Marie (Bloc contre bloc, 2019, Bloc populaire, 2021) appellent le « bloc populaire ». La première s’appuie sur un clivage droite-gauche qui n’a plus grand sens aujourd’hui, l’autre sur un rapport de classe qui s’affirme au contraire de plus en plus, au fur et à mesure que diminue le pouvoir d’achat et que se généralise la précarité. Ces deux manières de voir ne sont guère conciliables. A un moment où toutes les institutions qui fabriquaient hier du consentement sont entrées en état de crise systémique, il est difficile de prendre en compte les revendications des classes populaires, confrontées à la fois à la misère sociale et une immigration devenue immaîtrisable, et qui savent très bien que la question de l’identité nationale est indissociable de la question sociale, tout en s’employant à donner des gages aux patrons du CAC 40.
Attendons donc encore six mois. On saura alors si Zemmour est parvenu à autre chose qu’à faire réélire Macron.
Breizh-info.com : La politique tyrannique (officiellement sanitaire) mise en place par les autorités françaises se poursuit. La population française, dans sa majorité, semble avoir capitulé, tout du moins accepté, d’être réduite à présenter un code barre et une preuve de vaccination pour dîner en ville, aller au cinéma, etc. La soumission généralisée d’une population est-elle de tendance à vous inquiéter ?
Alain de Benoist : Vous oubliez quand même qu’au cœur même de l’été dernier, à une période de l’année où aucun syndicat n’a jamais osé organiser une manifestation, on a vu des centaines de milliers de Français défiler semaine après semaine pour protester contre le passe sanitaire. Du jamais vu.
D’un autre côté – je crois que nous en avons déjà parlé – il est clair qu’un grand nombre de gens sont prêts à abandonner leurs libertés quand ils croient leur sécurité ou leur santé menacée. La peur est le moteur premier de la servitude volontaire. Mais ce que vous interprétez en termes de soumission peut aussi s’interpréter en termes de résilience ou de pouvoir d’adaptation, sans que cela empêche la colère de gronder. La soumission généralisée, personnellement, je la verrais plutôt dans l’acceptation par les masses d’un système capitaliste qui est en passe de les déposséder de leur humanité.
Breizh-info.com : Vous avez publié récemment « Survivre à la désinformation », livre qui compile et reprend vos entretiens donnés à Nicolas Gauthier sur le site « Boulevard Voltaire ». Comment s’informer correctement dans une société ouverte qui produit de l’information à chaque seconde ?
Alain de Benoist : Il y a évidemment des sources d’information qui sont meilleures que d’autres. Inutile d’en faire l’énumération (Breizh-Info y aurait bien sûr sa place). Mais l’important n’est pas tant de savoir quelle quantité d’informations on absorbe que de savoir en évaluer l’importance. Le drame est que les médias actuels, du fait même de leur structure, interdisent de plus en plus de hiérarchiser les informations, et surtout d’en comprendre le sens et la portée. Montrer que les événements susceptibles d’avoir une véritable portée historique ne sont pas nécessairement (et sont même rarement) ceux dont on parle le plus est précisément l’un des objectifs de ce recueil.
Breizh-info.com : Finalement, quelle différence peut-on faire entre la personne sous-informée – c’est-à-dire celle qui ne regarde que le JT de 20 h ou ne lit que quelques extraits d’un quotidien régional – et la personne qui a la tête dans l’information toute la journée, à ne plus pouvoir prendre du recul dessus ?
Alain de Benoist : En fin de compte aucune. La première ne sait pas grand-chose, la seconde a entendu parler de tout mais n’y comprend rien. L’excès d’informations est parfaitement équivalent à l’absence d’informations, du fait d’un phénomène de contre-productivité dont Ivan Illich a donné bien d’autres exemples.
Breizh-info.com : Pour s’élever un peu et évoquer l’Europe et son avenir, comment analysez-vous les offensives de plus en plus violentes des commissaires de Bruxelles vis-à-vis des pays d’Europe centrale, Pologne et Hongrie en tête ? Pensez-vous que l’Union européenne puisse possiblement exploser, ou se scinder en deux ?
La Commission de Bruxelles ne supporte pas ce qu’elle présente invariablement comme des « atteintes à l’Etat de droit ». Cela n’a rien d’étonnant, puisqu’elle est l’un des vecteurs d’une idéologie dominante qui voit dans l’Etat de droit un moyen de soumettre le politique à l’autorité des juges et la souveraineté populaire à la morale des « droits de l’homme ». Les pays de l’Est, de leur côté, ont découvert que le « monde libre » qui les avait fait rêver à l’époque communiste est d’autant moins un exemple à suivre qu’il peut aussi constituer une menace. Dans la polémique que vous évoquez, la Pologne et la Hongrie ne sont pas isolées puisque le 7 octobre, pas moins de douze pays-membres (Autriche, Bulgarie, Chypre, Danemark, Estonie, Grèce, Hongrie, Lituanie, Lettonie, Pologne, République tchèque et Slovaquie) ont tenté de faire adopter un texte visant à ce que la Commission finance la construction de murs ou de clôtures de barbelés aux frontières extérieures de l’Union. Cette demande a bien entendu été rejetée, mais elle n’en reste pas moins significative.
On pourrait certes voir dans le groupe de Visegrád l’amorce d’une « autre Europe ». C’est un espoir raisonnable, mais il ne faut pas se dissimuler que les pays qui en font partie sont loin d’être d’accord sur tout. En matière de politique étrangère, par exemple, la Pologne continue de s’aligner aveuglément sur les États-Unis et professe une russophobie que la Hongrie ne partage pas. Il ne faut pas oublier non plus que la Pologne a beaucoup à perdre dans une épreuve de force avec l’Union européenne, car elle est actuellement la principale bénéficiaire des fonds européens. Plus qu’à une explosion, j’ai tendance à croire à une implosion de l’UE qui aboutirait à une dislocation de fait.
Breizh-info.com : En France, dans cette hypothèse, nous nous retrouverions alors sans doute dans le camp occidental… c’est-à-dire pas franchement le camp des défenseurs de l’Europe civilisation… Que faire alors demain pour maintenir les ponts fondamentaux ?
Alain de Benoist : Le risque de se retrouver dans le « camp occidental » me semble surtout considérable dans le bras de fer qui oppose actuellement Washington et Pékin, et qui pourrait très bien aboutir un jour ou l’autre à un conflit armé entre une hyperpuissance américaine déclinante et une puissance montante chinoise qui ne cesse de s’affirmer. Les Etats-Unis manœuvrent déjà pour reconstituer contre la Chine une « coalition occidentale » semblable à celle qui visait à contenir l’Union soviétique à l’époque de la guerre froide. En cas de guerre, la plus grande erreur pour les Européens consisterait à s’aligner sur Washington, au lieu d’adopter pour le moins une attitude de neutralité. L’Europe n’a pas vocation à faire la guerre aux Chinois !
Alain de Benoist, propos recueillis par Yann Vallerie (Breizh-info, 27 octobre 2021)